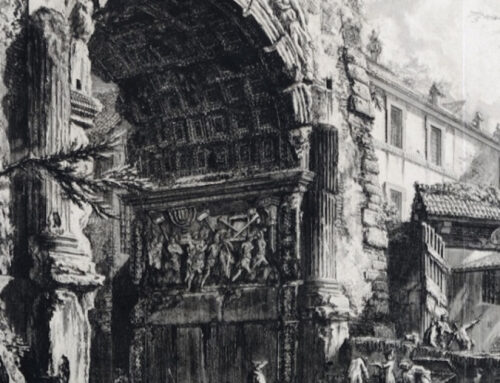Il est des notions qui prennent, dans le champ social, à notre insu le plus souvent et plutôt progressivement que brusquement, une importance considérable alors qu’auparavant elles étaient confinées dans une région bien délimitée du savoir. Le paysage est l’une de ces notions, comparable en cela à l’éthique, dont l’utilisation transdisciplinaire est en plein développement, qui, après avoir été surtout un des moments forts de la géographie classique, est devenue une sorte de paradigme illustré par de nombreuses disciplines des sciences de la nature et des sciences humaines.
De la domestication a la simulation du paysage
Il est des notions qui prennent, dans le champ social, à notre insu le plus souvent et plutôt progressivement que brusquement, une importance considérable alors qu’auparavant elles étaient confinées dans une région bien délimitée du savoir. Le paysage est l’une de ces notions, comparable en cela à l’éthique, dont l’utilisation transdisciplinaire est en plein développement, qui, après avoir été surtout un des moments forts de la géographie classique, est devenue une sorte de paradigme illustré par de nombreuses disciplines des sciences de la nature et des sciences humaines. Malgré cette omniprésence, le paysage n’en demeure pas moins extrêmement difficile à définir et l’on se retrouve face à lui comme Saint-Augustin face au temps: quand on ne me demande pas ce qu’est le temps, je le sais, mais quand on me le demande, je ne le sais plus. la mobilisation de cette référence n’est pas comme on pourrait le croire de l’ordre de la rhétorique dans l’exacte mesure où le paysage est tout à la fois temps et espace. La multiplication des travaux sur le paysage ne change rien à l’affaire et même si chacun d’euxapporte une moisson d’informations souvent remarquable, on en retire le sentiment d’un parcours asymptotique qui laisse une trace de désespoir dans l’esprit et qui suscite une courte question également chargée d’insatisfaction : et après ? Cette question non formulée aussi abruptement est peut-être l’une de celles qui a suscité le thème proposé sur le “ sens ” du paysage. Si l’on suppose que le mot a été pensé en référence à la signification qu’il fallait donner au paysage, on peut se laisser aller, aussi, à penser qu’il a été choisi en raison même de sa riche polysémie qui exprime en outre la sensation, la sensualité et la direction. Ne serait-ce que sur le plan de la langue, l’expression “ sens du paysage ” offre des entrées multiples différentes et complémentaires.
Il peut donc s’agir du paysage en tant qu’objet historique à la réalité duquel les sciences humaines tentent d’attribuer un sens sans pour autant oublier de prendre en compte la nécessité naturelle à côté de la notion de liberté propre aux acteurs qui à partir d’un donné ont créé un nouvel objet tout autant physique que métaphysique. C’est bien à cause de cette double appartenance qui fait se rencontrer la nécessité et la liberté que le paysage pose un problème essentiellement épistémologique si l’on se situe sur un plan théorique. Mais le paysage peut aussi être conçu comme source de sensation et de sensualité ce qu’il est lorsque romanciers et poètes s’en emparent pour le reconstruire à partir d’un regard solipsiste. Enfin, on peut se demander ce que le paysage devient ou peut devenir en tant que phénomène dynamique et alors on s’interroge sur la “ direction ” qu’il peut prendre ou qu’il prend tout simplement.
Je crois que tous ces sens font sens quand bien même ils n’auraient pas tous été prévus par les initiateurs du colloque pour laisser traiter le paysage dans sa double enveloppe de nécessité et de liberté. Je l’ai dit, la définition du paysage n’est pas aisée à donner, mais il est loisible de se demander s’il convient d’en donner une qui ne saurait être que la cristallisation d’un objet toujours en voie de cristallisation. Il y aurait contradiction – il y a contradiction – à cristalliser en une définition ce qui par essence est mouvement. Dans ces conditions la seule manière d’aborder l’objet est de chercher à construire un processus qui en rende compte sans le figer dans une définition toujours soupçonnable de “ fixisme ”. En tant que produit de l’interaction d’éléments organiques et inorganiques le paysage s’inscrit dans un processus de transformations continuelles et, si l’on fait abstraction du rôle de l’homme et de ses cultures, dans ce cas le développement du paysage naturel n’a pas de sens autre que celui d’une résultante sans cesse reprise et remodifiée par le jeu du vivant sur le non-vivant. Il est une forme de la diversité produite par la chaîne des relations qui s’établissent entre le biotope et la biocénose pour donner un écosystème en équilibre dynamique. C’est sur cette diversité produite que l’homme a projeté son travail – énergie et information – pour satisfaire ses besoins compte tenu des ressources disponibles dans sa culture. Le paysage humanisé, pendant longtemps n’a rien été d’autre que le résultat d’un processus de domestication de la diversité offerte mais non pas pour produire du paysage, qui n’est qu’un sous-produit, mais pour satisfaire des besoins. Ce n’est que beaucoup plus tard que le paysage a été conçu pour lui-même, non pas comme une fin en soi mais pour satisfaire, entre autres, les aspirations esthétiques déplacées vers le sommet de la pyramide des besoins et plus ou moins satisfaites.
Le paysage est une aventure, celle de la diversité donnée, offerte, celle-là même du corps de la terre que les hommes doivent apprendre à connaître mais celle, aussi, de la diversité produite par les éléments naturels sur le corps de l’homme et encore de celle produite par le corps social sur le corps de la terre et sur le corps de l’homme. Bien avant les présocratiques, les grands mythes mésopotamiens, égyptiens, hébraïques et grecs ont narré la diversité du monde. La narration a précédé la description de la diversité qui est à l’origine de la connaissance scientifique. Celle-ci s’est s’affranchie peu à peu des personnifications anthropomorphiques ou non pour entrer dans le système des éléments, des principes et des concepts : “Ce que la science répète le mythe l’avait déjà suggéré…” (Hans Blumenberg, 1979, p. 45). Mais nous ne cessons jamais de sortir du mythe pour entrer dans la science, nous sommes toujours sur cette étrange frontière qui fait communiquer le mythe et la science, nous ne cessons jamais de transgresser cette limite par la métaphore, pour passer d’une différence à une autre, pour utiliser ou composer des systèmes de différences. La diversité ne serait-elle pas, en fin de compte, un système cohérent et pertinent de différences, soit donné lorsqu’il est donné par le jeu des forces naturelles, soit produit lorsqu’il est le résultat des jeux intentionnels de l’action humaine sur la géo-diversité et sur la bio-diversité ?
Les cosmogonies sont des systèmes cohérents et pertinents de différences: la Genèse nous place en face de la diversité donnée mais aussi de la diversité produite par la transgression de l’interdit. Livré à lui-même, l’homme déchu, qui a goûté à la connaissance, va produire de la diversité. Désormais le corps de la terre, le corps de l’homme et le corps social seront livrés à la production c’est-à-dire à une vaste entreprise de modelage, voire de remodelage de ce qui a été donné en partage à “l’origine”. Origine ? Mot naïf mais indispensable quand bien même il est impossible d’en dire quelque chose pour le qualifier dans le temps et dans l’espace. Quand je dis “impossible”, j’entends qu’on a beaucoup dit, énormément dit, mais sans jamais fixer le moment et le lieu de cette origine qui ne cessent de changer, de bouger et d’être remis en question ! C’est tout le travail de la philosophie, de la science, des sciences. Nous avons tout produit à partir de la semence des mythes que nous avons manipulée, transformée, … domestiquée. Entre la Genèse et la théorie du big bang il y a bien évidemment toute “l’épaisseur” de la science mais la seconde, à l’instar de la première, est destinée à devenir un autre mythe et ainsi de suite … Les questions sont, formulations mises à part, toujours les mêmes mais les réponses sont innombrables : l’histoire de la pensée n’est qu’un gigantesque cimetière de réponses … dans lequel il reste toujours assez de vie pour relancer la question primitive. Parfois même des réponses ressuscitent, comme en témoigne l’hypothèse Gaïa (Lovelock, 1979). Si les questions sont des invariants structurels qui traversent le temps, les réponses, qui leur sont apportées, ressortissent à des morphologies dont la variabilité est grande sinon infinie.
Les hommes sont devant le monde comme devant les pièces d’un gigantesque puzzle qu’ils doivent assembler à cela près tout de même qu’il y a un grand nombre d’images possibles et pas seulement une qu’il conviendrait de retrouver. L’assemblage n’est pas singulier mais pluriel. Chaque culture humaine contient au moins un projet d’assemblage et par là même elle est créatrice de diversité par rapport à toutes les autres. Toute culture est un système cohérent et pertinent de différences dans l’exacte mesure où elle met en évidence, donc exalte, certains éléments ou pièces au détriment d’autres qu’elle laisse de côté, donc écarte. Une culture crée simultanément de la mémoire et de l’oubli : elle actualise et potentialise. Par le travail qu’elles projettent sur le corps de la terre, sur le corps de l’homme et sur le corps social, les sociétés créent de la diversité.
Produire de la diversité, c’est donc produire des différences conditionnées, sinon déterminées, par l’énergie et l’information à disposition d’un groupe humain, à un moment donné et dans un lieu donné. Géo-diversité – les formes de la terre -, bio-diversité – les formes de la vie – et socio-diversité – les formes sociales – constituent la “matière” sur laquelle les processus de la culture ne laissent pas de s’exercer. J’évoquerai deux processus toujours à l’oeuvre mais dans des conditions sensiblement différentes : la domestication et la simulation. Toute action humaine recourt simultanément à la domestication et à la simulation mais dans des proportions différentes. Si l’on reprend les catégories de Moscovici (Moscovici, 1968) à savoir les états de nature organique, mécanique et synthétique ou cybernétique qui décrivent d’une manière générale, mais néanmoins utilisables, les rapports de l’homme à la nature, on découvre que la part relative de la domestication tend à diminuer au profit de la simulation lorsqu’on passe d’un état de nature à l’autre. Pour prolonger la métaphore du puzzle, il est permis de dire que tout état de nature est une réordination différente des “pièces” qui fournit, dans chaque cas, une autre image du monde et de sa diversité dans l’élaboration de laquelle la domestication et la simulation sont mobilisées différentiellement.
Le processus de domestication
L’idée courante qui vient immédiatement à l’esprit quand on parle de domestication est celle d’apprivoisement, d’assujettissement et d’asservissement. Appliquer le terme à des organismes vivants et à des écosystèmes, c’est mettre en évidence leur soumission à l’homme et leur utilisation par celui-là. Mais parler ainsi d’une adaptation aux besoins de l’homme n’explique pas vraiment le processus.
La domestication conduit à produire des systèmes vivants qui ne peuvent plus se passer de l’homme autrement dit qui disparaissent lorsque l’homme cesse de s’en occuper : “… on peut considérer qu’il y a complète domestication lorsque la plante ou la bête, profondément transformée par le travail humain de sélection, ne peut, sans l’assistance humaine, ni se protéger, ni se nourrir, ni se reproduire” (Jacques Barrau, 1990, p. 36). Cela revient à dire que les organismes ou les écosystèmes domestiqués sont différents de ce qu’ils étaient avant l’intervention humaine. Dès lors qu’ils ne peuvent plus subsister sans l’assistance humaine cela signifie que l’homme a privilégié chez eux certains caractères et qu’il en a éliminé d’autres ne présentant pas d’utilité par rapport à son projet. Par la domestication, l’homme produit de la diversité, soit par hypertrophie soit par atrophie, celle-ci pouvant confiner à la disparition de tel ou tel caractère.
A partir d’une bio-diversité donnée, il est loisible, par le travail, de dessiner un autre tableau du vivant, une autre bio-diversité dont les interrelations et les morphologies sont modifiées. Ce processus d’intégration du vivant à l’histoire humaine, dont la flèche du temps est irréversible, implique une dépendance à l’endroit du temps humain et par conséquent un changement d’échelle de temps pour les espèces et les écosystèmes domestiqués. A l’échelle de temps originelle se substitue une échelle de temps définie par les usages sociaux que l’homme fait des “objets” domestiqués. A partir d’un objet vivant donné, sorti de son temps naturel propre, un autre objet est produit et intégré au temps social du groupe qui l’a domestiqué. L’objet domestiqué est, en fait, un nouvel objet qui reflète la marque du système d’intentions encadré par la culture du groupe. La nouvelle bio-diversité produite est adaptée aux usages sociaux. Mais que cesse la domestication, parce que les usages se modifient, et c’est toute la bio-diversité produite qui est remise en cause. Si les usages s’estompent ou disparaissent, alors les hommes ne consentent plus l’énergie et l’information nécessaires à l’existence des objets domestiqués qui, laissés à eux-mêmes, vont tout simplement péricliter et mourir. La bio-diversité produite est temporellement instable puisque ce sont les usages qui en définissent les durées de vie.
Mais les échelles de temps ne sont pas les seules en cause. L’échelle spatiale est également modifiée. Les ressources étant limitées, le processus de domestication conduit aussi à sélectionner les lieux dans lesquels l’homme investit ses efforts et par là substitue à l’échelle de la diffusion naturelle l’échelle des usages dans l’espace. La géo-diversité en est donc affectée et là encore on assiste à une production “d’espaces” par exaltation de certains lieux et mise à l’écart d’autres. Les choix relatifs aux localisations révélés par l’observation dans le terrain ne laissent pas d’étonner parfois. Pourquoi de deux lieux, pourtant voisins et apparemment semblables quant à leurs caractéristiques, l’un est nettement préféré à l’autre ? Des raisons historiques peuvent être évoquées mais alors elles renvoient à la culture qui ne fournit pas toujours une réponse univoque sinon à travers une modification des usages induite par un nouveau système d’intentions dont la nature peut-être politique ou économique, par exemple. Là encore, comme pour le temps, la géo-diversité n’est pas stable. Une lecture diachronique de la géo-diversité produite montrerait, si elle était entreprise, qu’il n’y a de nécessité géographique que parce qu’il y a de l’histoire. Une plaine, une montagne ou un fleuve ne sont-ils pas déclinés différemment au cours du temps par les sociétés qui les “utilisent” ? A partir d’une même géo-diversité donnée, l’homme produit des géo-diversités nouvelles et différentes. Celles-ci ne sont alors rien d’autre que des images de la géo-diversité originelle remodelée et réordonnée. Pour prendre une métaphore graphique, on peut dire que l’image de la géo-diversité originelle est en quelque sorte une anamorphose dont il faut retrouver le modèle de déformation explicite ou implicite. Ces images sont des caricatures de la nature donc des systèmes de différences pertinents et cohérents mais déformés. Cela dit, tout modèle est une caricature et la diversité produite est une caricature de la diversité donnée à beaucoup d’égards : “L’art du caricaturiste est de saisir ce mouvement parfois imperceptible, et de le rendre visible à tous les yeux en l’agrandissant. … “Il réalise des disproportions et des déformations qui ont dû exister dans la nature à l’état de velléité, mais qui n’ont pu aboutir, refoulées par une force meilleure” (Henri Bergson, 1941, p.20). La domestication, sans le savoir, s’apparente à l’art du caricaturiste. N’est-elle pas au fond une théorie implicite et pragmatique de la caricature appliquée à la nature, à la diversité donnée, pour produire une diversité par hypertrophie ou par atrophie, c’est-à-dire selon une loi de croissance allométrique ?
La production de la diversité joue donc sur les échelles. Elle part d’un objet donné à l’échelle 1/1 dans lequel elle sélectionne des caractéristiques dont elle change les échelles par rapport au tout. Certains éléments sont traités à l’échelle 1/n, n pouvant être supérieur à 1 dans le cas de l’atrophie ou inférieur à 1 dans le cas de l’hypertrophie : l’objet domestiqué produit est alors au plein sens du terme une caricature de l’objet donné. En somme, la diversité produite devient une fonction du jeu des échelles commandé par des choix culturels qui mettent l’accent sur tel ou tel élément de l’objet donné comme moyen de remplir un usage spécifique. Les choix culturels, qui modifient la nature originelle des objets donnés, sont, dans ce cas, assimilables à des projections cartographiques qui modifient la représentation de l’objet géographique.
Par la domestication l’homme ne modifie pas seulement la bio-diversité et la géo-diversité mais encore lui-même puisque ses relations ont lieu dans un environnement transformé. Par son action l’homme pratique une sorte d’auto-domestication, sans le savoir ni le vouloir, au cours de laquelle il modifie son corps et aussi sa pensée. L’évocation de cette question, que je ne traiterai pas, a simplement pour objectif de montrer que le processus de domestication a des effets multiples.
Le processus de simulation
Quand bien même la domestication a prédominé longtemps dans les processus d’ajustement des différents environnements physique et social, pour les transformer en “territoires de vie” l’autre processus, celui de simulation, n’a jamais été absent puisque dans toute opération de création de la diversité, on peut retrouver un projet ou un modèle de base plus ou moins clairement formulé.
La simulation ne part pas, comme la domestication, de l’échelle 1/1 pour ensuite jouer sur l’objet en le déformant mais procède d’une image réduite d’un objet à produire. L’échelle de l’image réduite étant à l’échelle 1/n (n étant plus grand que 2). La méthode de la simulation étant progressive et non pas régressive comme celle de la domestication. Pour reprendre les catégories de Moscovici des états de nature, on peut prétendre que la part de la simulation n’a fait que croître de l’état de nature organique à l’état de nature synthétique ou cybernétique en passant par l’état de nature mécanique. Le rôle croissant de la simulation est en corrélation positive avec celui du travail d’invention. La limite du processus de simulation serait la création d’un monde entièrement produit par l’homme, à l’échelle 1/1, à côté du monde réel ! Entreprise démente qui n’est pas sans rappeler l’apologue de Borgès (Borgès, 1951, p. 129-130) dans lequel l’empereur fait lever la carte à l’échelle de l’empire ! Comme le logicien ne manquerait pas de le dire : où mettrait-on ce “ monde nouveau” doublant le monde donné ? Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la contrainte logique mise à part, on aurait un maximum de diversité, produite à partir d’un minimum de diversité donnée.
Parviendrait-on alors à maîtriser cette diversité produite mieux qu’on ne maîtrise celle donnée ? On peut en douter. Qui ne connaît l’expérience de Biosphère 2 aux États-Unis qui a consisté à faire vivre des hommes et des femmes dans une série d’écosystèmes, créés de toutes pièces, devant assurer une autonomie suffisante à la vie humaine. Assez rapidement on s’est rendu compte malgré la présence de nombreux végétaux qu’il y avait un problème d’oxygène. Même si on a identifié, après coup, la raison de cette défaillance, il a fallu injecter rapidement de l’oxygène pour éviter l’asphyxie des “habitants” de Biosphère 2.
Vico avait peut-être raison de dire qu’on ne connaît bien que ce qu’on fabrique mais cette connaissance n’en demeure pas moins fragmentaire car les nouvelles relations qui s’établissent entre les éléments produits nous échappent dans une large mesure, en ce sens que leur interaction acquiert une vie propre à la connaissance de laquelle il faut s’attacher. On constate donc que cette volonté de maîtrise de tout le processus par l’homme correspond au désir d’éliminer le risque ce qui est, évidemment, impossible. Ce désir toujours incomplètement satisfait relance la volonté de connaître. Même avec la simulation l’histoire n’a pas de fin, au contraire celle-là relance celle-ci.
Cette tentative d’éliminer le risque nous propulse vers une situation utopique. La relation entre simulation et utopie n’est pas accidentelle. L’utopie, qui renvoie à une situation “parfaite”, du moins considérée comme telle, par ceux qui l’imaginent, est une bonne illustration de la simulation puisqu’elle est construite à partir de caractères élémentaires empruntés à des objets réels, détachés de leur contexte, mais recombinés et réordonnés de manière à constituer une unité entièrement nouvelle. Simulations purement intellectuelles, les utopies de l’Antiquité jusqu’à nos jours n’ont, sauf rares exceptions avortées, pas eu d’effet de transformation sur le monde réel : elles ont produit de la diversité virtuelle dont l’incorporation à l’imaginaire social a cependant marqué la mémoire collective. L’histoire de la cité idéale d’Hippodamos de Milet à Le Corbusier est une magnifique introduction à la simulation (Vercelloni, 1994).
Avec l’avènement du machinisme, de la chimie de synthèse et de l’ordinateur, entre autres choses, la simulation est devenue un processus d’une importance considérable dans les sociétés techniciennes. En effet, elle est une exploration algorithmique, génératrice d’images et de modèles, qui invente des “natures” dont les échelles sont choisies au gré de l’utilité recherchée. Par la simulation, on a produit des dizaines de milliers de matières qui n’existaient pas à l’état naturel et qui sont le fruit de synthèses complexes et on a corrigé, modifié et même inventé du vivant en partant de la génétique. Le génie génétique est en train de créer un nouveau monde du vivant. Toute cette diversité fait aujourd’hui partie de notre environnement et dans bien des cas, elle est même responsable de sa destruction partielle. Une chose est certaine : elle n’est pas maîtrisable puisque dans la plupart des cas, on ignore ses effets qu’on ne découvre souvent que longtemps après… Les conséquences pour le corps de la terre, pour le corps de l’homme et pour le corps social sont évidemment pleines de promesses mais aussi de risques.
De proche en proche, par la simulation l’homme a conçu et fabriqué des écosystèmes dont la diversité est entièrement produite. La ville est l’exemple le plus caractéristique de ces écosystèmes entièrement produits. La ville occupe d’ailleurs une place considérable sur l’horizon de notre quotidien, si considérable que pour un nombre croissant de ses habitants les rapports avec la diversité donnée sont de plus en plus rares. L’homme de la ville est plongé dans un univers qui le façonne presqu’entièrement : ses relations sont conditionnées bien davantage par la diversité produite que par la diversité créée dont les rémanences sont de plus en plus discrètes.
A considérer les problèmes actuels, force est de reconnaître que la ville échappe aux individus qui l’habitent d’une part et aux autorités chargées d’en assurer la gestion d’autre part. Ce n’est pas que la ville serait brusquement pourvue d’une vie propre incontrôlable c’est que la ville est devenue le lieu de relations multiples déclenchées par des sphères dont l’autonomisation atteint un degré extrême. La ville est livrée, par le jeu des marchés légaux ou illégaux, à la monnaie dont les flux font et défont les morphologies urbaines, modifient ou détruisent le tissu socio-culturel, transforment la vie en quelque sorte.
La simulation contemporaine commence toujours par des jeux d’argent : il s’agit, chaque fois, d’évaluer le coût de telle production de diversité et surtout d’en escompter les bénéfices … monétaires. Il est devenu banal pour les économistes de faire une évaluation des richesses “naturelles”, c’est-à-dire de toute cette diversité créée, en termes monétaires. Tout a un prix et tout peut en avoir un, de l’inorganique à l’organique, de l’objet à l’homme. La valeur d’échange l’emporte sur la valeur d’usage dans la ville d’où une instabilité des rapports puisque ceux-ci s’inscrivent dans le temps court.
Alors que la domestication accordait encore une grande importance aux choses réelles, la simulation travaille davantage sur le signe des choses d’où le rôle accru de la monnaie. La régulation de l’usage des choses ne se situe plus dans les choses elles-mêmes mais dans les signes monétaires qui les représentent.
Désormais le champ est libre à la production de diversité entièrement conditionnée par les flux de capitaux qui se déplacent d’un point à un autre de la planète. Vitesse de circulation et accumulation de la monnaie décident de la diversité produite. Plus rien n’est à l’abri de ces bouleversements : ceux qui possèdent les capitaux et l’information scientifique sont en train de faire main basse sur la bio-diversité des pays du Sud, c’est-à-dire de la confisquer au niveau génétique pour se livrer à de vastes opérations de manipulation pour exploiter la diversité qui sera l’objet de marchés lucratifs.
Le Nord, après avoir détruit beaucoup de diversité créée, dans le passé, est en train d’en découvrir l’importance économique et cherche à s’en assurer la disponibilité. Dans le même temps, il modifie la socio-diversité qui pourrait faire obstacle à ses projets. Cela revient à dire qu’il tend à homogénéiser les populations dont les différences ne lui semblent pas pertinentes. Autrement dit on est en train de faire avec la socio-diversité ce qu’on a fait autrefois avec la bio-diversité qui n’était pas jugée compatible avec les usages que l’on voulait promouvoir d’où la disparition de pratiques et de connaissances qui s’enracinaient dans des cultures traditionnelles. Qui pourrait prétendre que nous n’aurons pas besoin des apports de ces cultures traditionnelles et qu’elles ne seront pas à un moment donné, pour demeurer dans la logique cynique de celle décrite plus haut, utiles au Nord et à leur tour “objet” de marché ?
N’assiste-t-on pas, en effet, depuis déjà un bon nombre d’années, dans nos régions à des tentatives de réinvention de la socio-diversité traditionnelle pour en faire, à travers le tourisme et les activités de loisir, des objets de marché. Bien sûr, ce ne sont là que des images dont la reproduction n’a plus rien à voir avec la réalité vécue. La simulation nous propose de plus en plus d’images et nous contraint, faute de mieux, à les habiter et à les traverser. Potemkine avec ses villages factices destinés à tromper Catherine II sur le véritable état de la Russie, quand bien même l’anecdote serait apocryphe, pourrait être l’ancêtre de la simulation opératoire en matière de socio-diversité produite à l’échelle 1/1.
Habiter des images…
Si par la domestication, l’homme s’est inséré dans l’enveloppe spatio-temporelle en substituant ses propres échelles à celles de la biosphère, il n’en a pas moins détruit, en partie, par la même occasion, les bases mêmes de son existence. L’expansion humaine a pu se réaliser ainsi par “clairières” successives qui ont été soustraites à l’environnement dont l’équilibre s’est maintenu sans trop de difficultés jusqu’à la révolution industrielle même si, ici et là, des destructions irréversibles ont eu lieu. L’exaltation protéiforme de la nature au XVIIIe révèle, sans aucun doute, le malaise de la société occidentale dont les modèles envahissent non seulement la pensée mais encore l’existence. Il faudrait faire une histoire des images de la nature qui montrerait à quel point l’homme a perdu ses repères : on ne sait pas ce qu’est la nature mais elle est l’objet de tous les discours, de toutes les nostalgies et de toutes les préoccupations. Ce n’est pas par hasard si la notion de paysage, empruntée à la peinture, va devenir l’horizon sur lequel vont se profiler tout autant les desseins littéraires que scientifiques. Image par excellence, le paysage fonde à lui seul un paradigme qui, deux siècles plus tard, nourrira encore la description littéraire et la description scientifique, qu’il s’agisse des sciences de la nature ou des sciences de l’homme. La description du paysage n’est en aucune manière la description d’une portion de nature mais bien autre chose : c’est la recherche, par l’homme, de son essence à travers la médiation de l’extériorité. Cette recherche de l’essence est un héritage de la philosophie grecque qui depuis les présocratiques s’est efforcée d’extraire, des flux vitaux des phénomènes, l’essence stable des choses qui combinée avec la tendance à la description a finalement donné une impulsion considérable à la production des images de la nature.
Le privilège accordé à l’essence plus qu’à l’existence, à la représentation plus qu’au référent constitue probablement un des points d’ancrage de la simulation dont le développement s’est accéléré avec la crise sans précédent que connaît la biosphère. Après avoir largement entamé son patrimoine “naturel” qu’il continue de méconnaître dans ses profondeurs, l’homme contemporain se trouve confronté à l’idée de la réinvention de ce qu’il a compromis gravement, voire détruit. Mais la réinvention est, elle-même, incertaine dans la mesure où les modèles sur lesquels elle s’appuie ne reflètent qu’une connaissance insuffisante des interactions entre les éco-bio-et socio-logiques qui conditionnent l’ensemble des cycles dans lesquels l’homme intervient.
Les images de la nature produites par la simulation ne peuvent être qu’instables et, de fait, elles le sont. L’exemple le plus typique de cette simulation en acte est fournie par ce que font les architectes et les urbanistes qui “inventent” des paysages dont la durée est généralement faible d’une part et dont l’extension ne peut être que limitée pour les raisons évoquées plus haut d’autre part. La construction presque ex nihilo des paysages touristiques est une illustration de plus en plus fréquente de la simulation. Les modèles de l’exotisme sont ainsi conçus à l’échelle 1/n puis testés par le marketing pour “accrocher” de la manière la plus sûre la clientèle urbaine qui doit trouver, à l’échelle 1/1, la réalisation de ses rêves les plus secrets et les plus fous. Ce n’est plus la nature qui est habitée mais des images ou si l’on préfère des décors grandeur nature qui pourront être modifiés au gré de l’évolution des goûts et des préférences. Il n’y a plus de séjour parmi les choses mais une traversée des choses, une traversée de décors comme dans le cas des villages de Potemkine qui se déplaçaient au rythme des voyages de Catherine II pour faire illusion.
Il est urgent de se demander si la véritable crise de la nature ne réside pas davantage dans la préférence que nous accordons à ses images plutôt qu’à elle-même. Jonas n’aurait-il pas raison lorsqu’il prétend que l’Homo Faber est en train de supplanter l’Homo Sapiens ? Même si les hommes ont besoin de la nature, ils agissent comme s’ils pouvaient s’en passer. En revanche, ils ont besoin de l’idée de nature comme on a besoin d’un en-deça et d’un au-delà et c’est pourquoi cette idée est indestructible quand bien même la chose ne l’est pas.
L’histoire de nos relations à la nature est-elle autre chose, en fin de compte, que la chronique d’un exil, celui de la nature “donnée”, qui nous contraint sans cesse à imaginer des natures “produites” ? Celles-ci ne pourront pas s’inscrire dans la traditionnelle description puisqu’elles seront “description”, par définition, avant même d’exister matériellement. En revanche, elles seront narration dans la mesure où elles exprimeront sous une forme “épique” ce qui leur aura donné naissance. La forme moderne de l’épopée ne serait-elle pas la chronique des inventions de la simulation ?